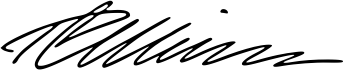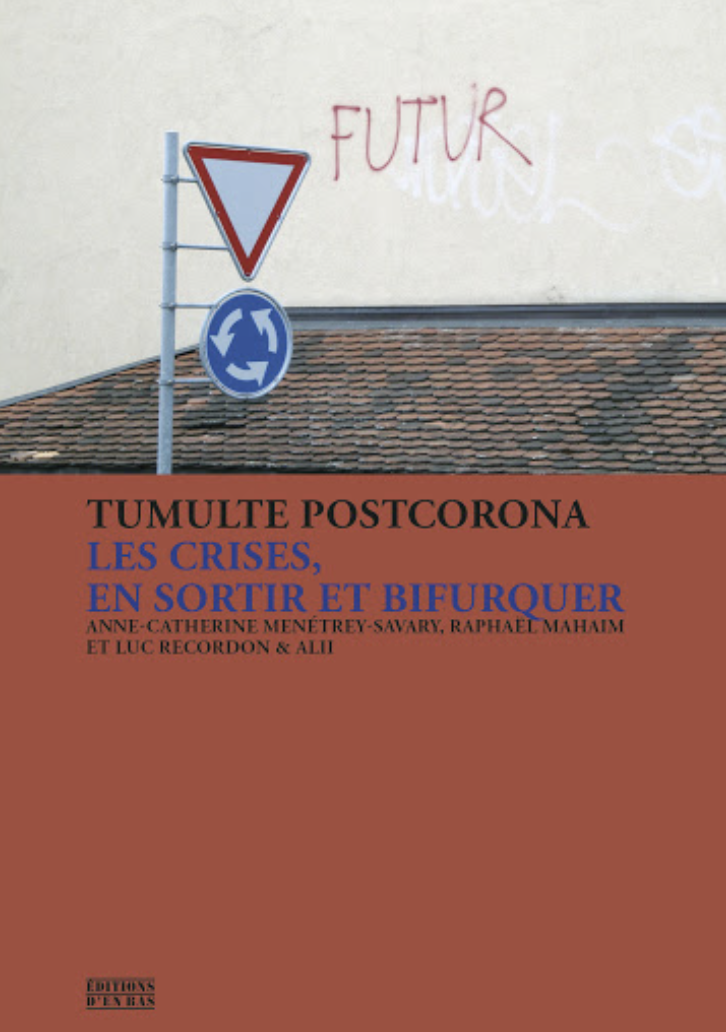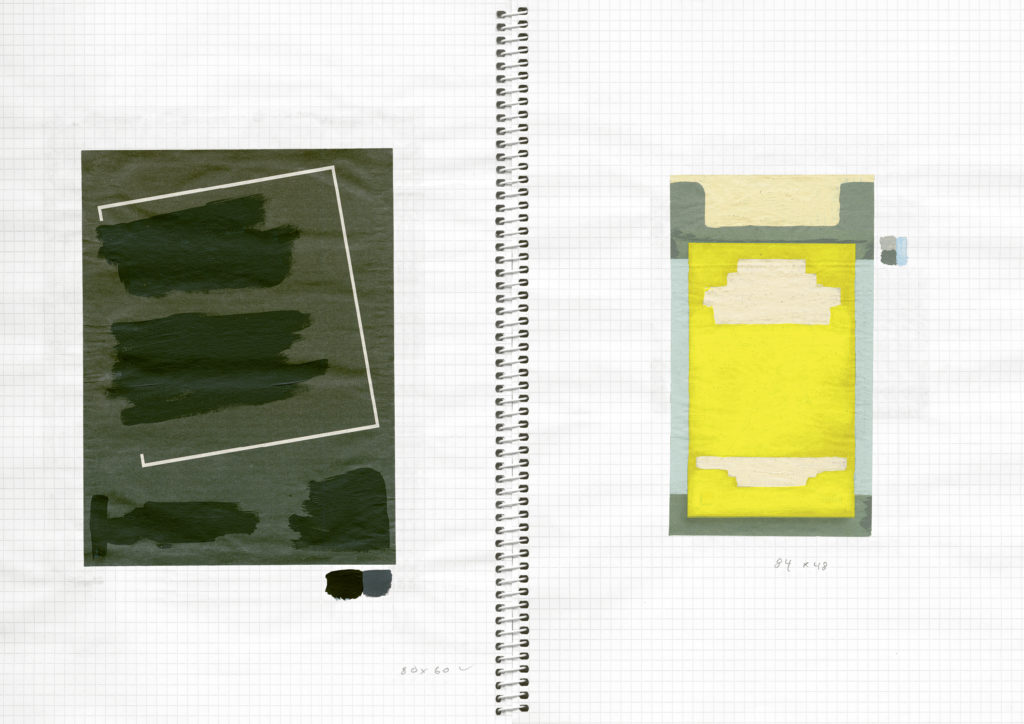NINA
(extrait)
Alek ne sut rien des pérégrinations de sa femme. S’il avait su, il aurait sans doute voulu interdire. Mais Nina n’était pas femme à se laisser interdire quoi que ce soit. Ce tourbillon de vie, une fille intelligente, rayonnante, courtisée de tous côtés, avait accepté de l’épouser. Il se savait chanceux. Les prétendants se talonnaient jusque dans les escaliers de l’ancien immeuble familial, entre les odeurs d’humidité, de rouille et de boulettes de viande brûlées, dans le courant d’air permanent qui soufflait à travers des lucarnes décaties. Ils faisaient la queue, patientaient pour dégoter une entrevue. Nina se vantait de ne jamais les laisser entrer. Elle n’aurait pas cédé à un racolage aussi vulgaire. Pour la conquérir, il fallait l’attendrir. Bien sûr, elle avait eu des amants, plus qu’elle n’était prête à l’avouer, Alek s’en doutait bien. Mais il fut le seul – lui, Aleksander Alexeyevitch, fils d’ennemi du peuple, dont le stigmate était pourtant inscrit jusque dans le passeport – dont elle eut accepté la demande en mariage. Ils s’étaient rencontrés l’été, en Lituanie, à la maison de repos où ils passaient tous deux leurs vacances. Feux de camp, baignades nocturnes, balades forestières, murmures sur les bancs longeant la promenade maritime: ils riaient comme des enfants et sentaient croître, jour pour jour, une tendresse irrépressible l’un pour l’autre. Leur noce avait été célébrée seulement quelques semaines après leur retour à Moscou, au début du mois de septembre 1954.
Cette semaine, entre ses allées et venues dans les magasins gastronomiques, Nina fit un crochet par la clinique pour femmes n°147. Ici aussi, il fallut attendre, debout puis coincée sur une minuscule chaise en acier. Dans le cabinet médical au papier peint rose saumon, la gynécologue l’interrogea sommairement, sans lever la tête de son bloc-notes : – tu viens pour quoi ? – la date des dernières règles? – c’est la première fois? Elle s’allongea, des mains gantées de plastique vinrent palper ses organes, d’abord de l’extérieur, elles pétrirent ses bourrelets, les coincèrent entre les phalanges et les ongles… Nina pensa au tourniquet du métro, à ses griffes qui se refermèrent sur ses entrailles un jour où, distraite, elle n’avait pas avancé assez vite après avoir jeté sa pièce dans la machine. Les doigts s’insinuèrent en elle, ils fouillèrent, écartèrent la chair, l’étirèrent, s’enfoncèrent, soupesèrent ovaires, trompes, col de l’utérus. – T’es fatiguée ? – Oui. Des nausées ? Nina s’arracha un soupir d’approbation : la doctoresse venait de faire pivoter l’un de ses ovaires sur lui-même, comme une balle de tennis. – Eh bien voilà ma belle, qu’est-ce qu’on dit, félicitations, t’es enceinte !
Nina n’avait pas eu le temps de dire grand-chose. Elle ne savait pas si elle était contente. De toute façon, on ne lui posa pas la question. Elle se dirigea vers la station de métro, les bottes piétinant dans la neige brunâtre, mâtinée de boue. Elle se trompa plusieurs fois de direction. Elle se sentait lourde, une légère douleur enroulée en boule appuyait là où les règles tiraillaient d’habitude. Quatre mois s’étaient écoulés depuis le mariage. C’était logique que cela arrive maintenant. Tout le monde attendait ça, plusieurs de ses amies avaient déjà accouché. Iakob, son père, faisait des plaisanteries à tour de bras : il attendait son sacre en tant que grand-père avec impatience. Seule sa mère restait étrangement silencieuse sur la question. Sonia avait eu Nina sur le tard, elle avait déjà passé la trentaine ; elle travaillait comme couturière à l’usine depuis plus de dix ans, une employée consciencieuse, fidèle et taiseuse, une stakhanoviste à laquelle sa fille reprochait souvent sa rigueur ascétique. Elle ne partageait pas ses états d’âme avec elle. Au mariage de Nina, sa mère avait opiné du chef, un sourire avait détendu ses traits, le visage légèrement adouci par les cheveux relâchés pour l’occasion ; Alek était un homme bien, elle pouvait remettre sa fille entre ses mains sans se faire trop de bile. Pourtant, Sonia savait que son gendre faisait partie des maudits: en 1938, sa famille avait reçu un courrier type, le père d’Alek était « détenu sans droit à la correspondance », en d’autres mots : il avait été fusillé. Voilà qui ne faciliterait pas les choses pour sa fille, Sonia ne put s’empêcher de le penser, mais jamais elle ne fit la moindre remarque sur ce point.
Marina Skalova
© Revue Rabotnitsa (« La Travailleuse »), numéro de 1968/2